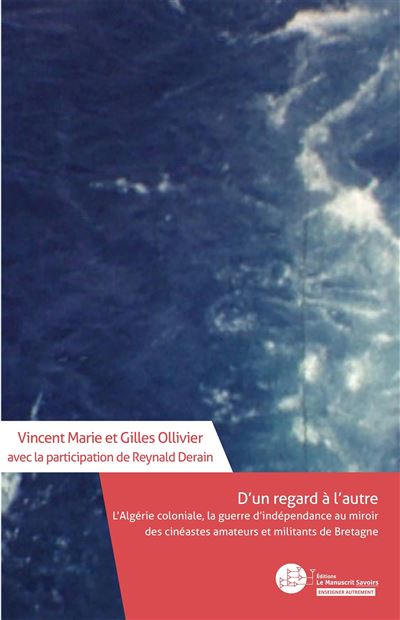D'un regard à l'autre
Réalisation Vincent Marie et Gilles Ollivier
Support LIVRE
- Un livre - D’un regard à l’autre : L’Algérie coloniale, la guerre d’indépendance au miroir des cinéastes amateurs et militants de Bretagne
Vincent Marie et Gilles Ollivier, avec la participation de Reynald Derain
Éditions Le Manuscrit, collection Enseigner autrement, 2025Après la réalisation, en 2022, dans le cadre des commémorations des 60 ans des accords d’Évian et de l’indépendance de l’Algérie, d’un dossier historique autour des cinémas amateur et militant, confié par la Cinémathèque de Bretagne pour son site à Gilles Ollivier, Vincent Marie et Reynald Derain, historiens et enseignants, cette étude vient de paraître aux éditions Le Manuscrit, dans la collection Enseigner autrement. Circonscrite aux réalisateurs de Bretagne, elle interroge la manière dont les images tournées en Algérie dans le contexte historique de la colonisation et de la guerre d’indépendance, partagées entre « images-souvenir » et « images-mémoire », et conservées par la Cinémathèque de Bretagne, jouent un rôle primordial dans la compréhension de ces évènements majeurs pour les deux États.
L’ouvrage, augmenté, coédité par la Cinémathèque de Bretagne, avec la participation de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG), est préfacé par l’historien Tramor Quemeneur et l’historien Abderahmen Moumen en a écrit la postface. La publication s’adresse aux enseignants et à leurs élèves, aux chercheurs, mais aussi à tous les passionnés de cinéma invités à découvrir des films tournés des années 1930 aux années 1960. Il propose une approche chrono-thématique pour questionner l’usage du film comme outil de mémoire historique et/ou personnelle.Croiser les regards sur les populations et la culture algériennes pendant la colonisation et souligner ce qu’ils montrent ou dévoilent pendant la guerre d’indépendance (1954-1962) s’avère ici programmatique. Extraits de films de voyage, de Français d’Algérie, de soldats français (engagés et (r)appelés) sont analysés et confrontés afin de caractériser les points de vue en matière d’altérité. Il en est de même pour la vision portée par le cinéma militant de René Vautier, cinéaste français d’origine bretonne favorable à l’indépendance algérienne.
Trois parties constituent l’étude. Après avoir abordé les cinémas amateur et militant comme sources et objets d’études de l’histoire franco-algérienne, les auteurs proposent de réfléchir en quoi l’Algérie filmée par des cinéastes amateurs de Bretagne a participé à la construction d’un imaginaire entre regard européen et vie algérienne. Ils invitent enfin à s’intéresser aux parcours singuliers de trois cinéastes : le cinéaste amateur-résident Albert Weber, le rappelé Philippe Durand, qui autoproduit son film Secteur postal 89 098, et le cinéaste professionnel-citoyen René Vautier.
Les lectrices et les lecteurs pourront tracer leur propre parcours en visionnant les films abordés dans l’ouvrage grâce à des QR codes, à l’exception de ceux de René Vautier qui ne sont pas actuellement en accès libre.
Par ce large corpus décrit et analysé, il s’agit de montrer que les cinémas amateur et militant, cinémas atypiques, sont constitués de films qui construisent eux aussi une forme cinématographique de l’histoire.
Prix TTC 20,00€
Votre panier
Rechercher